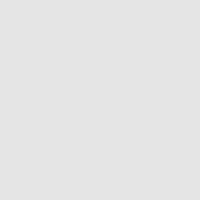Comment le poids impacte t-il notre santé ?
À l’échelle mondiale, la prévalence du surpoids et de l’obésité ne cesse d’augmenter (plus de 1,9 milliard d’adultes en surpoids selon l’OMS, dont plus de 650 millions obèses), tout comme la problématique inverse du sous-poids dans des contextes de précarité, de maladies chroniques ou de troubles du comportement alimentaire. Ces préoccupations sont majeures pour la santé publique en raison des multiples complications qui y sont associées. Dans cet article, voyons comment le poids impacte notre santé.
Les risques physiques liés au surpoids et à l’obésité
Le surpoids est caractérisé par un IMC (Indice de Masse Corporelle) compris entre 25 et 29,9. On parle d’obésité lorsque l’IMC dépasse 30. Ces deux états physiques, notamment l’obésité, favorisent la survenue de certaines maladies.
Diabète de type 2
La graisse viscérale, c’est-à-dire celle de la cavité abdominale autour des organes, favorise l’apparition d’une résistance à l’insuline, principale cause du diabète de type 2. Ce type de diabète survient parce que les cellules deviennent moins sensibles à l’action de l’insuline : cela entraîne une hyperglycémie chronique nuisible aux vaisseaux sanguins et aux organes.
Maladies cardiovasculaires
Le surpoids et l’obésité augmentent le risque d’hypertension artérielle, de maladies coronariennes et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC). Ces risques s’expliquent par l’accumulation de graisses dans les parois des vaisseaux sanguins (athérosclérose), les modifications du métabolisme lipidique et l’inflammation systémique entretenue par les cellules adipeuses.

Certains cancers
Le surpoids et l’obésité sont associés à une augmentation du risque pour plusieurs cancers, notamment ceux du sein (chez la femme ménopausée), du côlon, du rein, de l’œsophage et de l’endomètre. Le mécanisme repose sur différents paramètres, dont les modifications hormonales et l’inflammation chronique.
Troubles respiratoires
L’obésité favorise l’apnée du sommeil. Elle est causée par la compression des voies respiratoires supérieures par la graisse cervicale. Aussi, elle augmente le risque d’asthme. Tout cela induit des pauses respiratoires nocturnes, une mauvaise oxygénation et un sommeil de mauvaise qualité, source de fatigue chronique.
Complications musculo-squelettiques
L’excès de poids sollicite fortement les articulations, en particulier celles des jambes et du dos. Cela peut accélérer le développement d’arthrose (et donc l’usure du cartilage), de douleurs lombaires et de limitations fonctionnelles. L’obésité augmente aussi la pression sur les tendons qui peuvent souffrir d’inflammation.
Autres pathologies
D’autres maladies ont un plus gros risque d’apparaître chez les personnes obèses :
- Les calculs biliaires : Ils sont plus fréquents, car l’obésité altère la composition de la bile.
- La stéatose hépatique (foie gras non-alcoolique) : Accumulation de graisse dans le foie qui peut progresser vers la cirrhose.
- Troubles rénaux : L’obésité accentue le travail des reins et peut donc favoriser la survenue de maladies liées à cet organe.
Les conséquences psychiques et sociales de l’obésité
Dépression, anxiété, troubles de l’image corporelle
L’obésité et le surpoids accroissent le risque de troubles psychiques tels que la dépression, l’anxiété, ainsi qu’un mal-être lié à la perception corporelle. La stigmatisation sociale favorise l’isolement, un repli sur soi et parfois des troubles du comportement alimentaire.
Stigmatisation et exclusion sociale
Les personnes en situation d’obésité font face à des préjugés, discriminations à l’école, au travail, dans le système de santé, qui impactent leur estime de soi et limitent parfois leurs possibilités de soin et d’intégration sociale.
Impact sur la qualité de vie et la santé mentale
La surcharge pondérale réduit la mobilité, accroît la fatigue, limite les activités, toutes conditions qui affectent négativement la qualité de vie globale et la santé mentale au quotidien.
Les risques physiques liés à l’insuffisance pondérale
Lorsque l’on se demande comment le poids impacte notre santé, nous pensons directement au surpoids. Pourtant, l’insuffisance pondérale amène aussi avec elle son lot de conséquences sur la santé. Celle-ci est caractérisée par un IMC en-dessous de 18.
Malnutrition, carences
Un poids insuffisant expose à la carence en nutriments essentiels (protéines, fer, calcium, vitamines), qui compromet le bon fonctionnement de l’organisme. La masse musculaire et osseuse diminue, ce qui fragilise la santé globale.
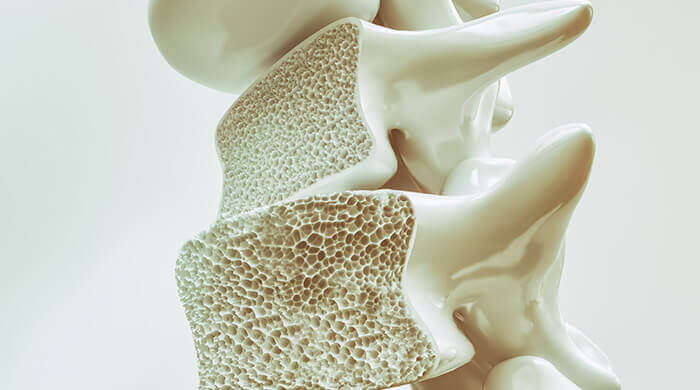
Faiblesse immunitaire et augmentation des risques d’infection
Les personnes souffrant d’insuffisance pondérale présentent une diminution des défenses immunitaires : elles tombent plus fréquemment malades et guérissent moins vite, du fait d’une moindre production d’anticorps et d’éléments cellulaires immunitaires.
Ostéoporose et troubles hormonaux
Le déficit chronique en apport énergétique et nutritionnel entraîne une perte de densité osseuse (ostéoporose), et, avec elle, un plus grand risque de fractures. Chez la femme, il peut causer des troubles hormonaux comme l’aménorrhée ; chez l’homme, une baisse des taux de testostérone.
Les conséquences psychiques et sociales du sous-poids
Dépression, anxiété, troubles de l’image corporelle
Les difficultés à prendre du poids, parfois accompagnées de moqueries et de jugements, favorisent les troubles psychologiques (anxiété, dépression), le repli sur soi et les troubles du comportement alimentaire.
Stigmatisation et exclusion sociale
Comme l’obésité, le sous-poids expose à des préjugés et à la marginalisation, que ce soit dans la sphère privée, scolaire ou professionnelle.
Impact sur la qualité de vie et la santé mentale
Le sous-poids altère la performance physique, la capacité à réaliser des tâches quotidiennes, l’endurance, la concentration, et mène souvent à la perte d’autonomie et à l’isolement.
Poids corporel et impact sur la santé : les limites de l’IMC
L’IMC est utile pour fournir un repère médical international, mais il a ses limites : il ne différencie pas la masse grasse de la masse musculaire, et peut conduire à des classifications erronées (chez les sportifs musclés, par exemple). Les médecins recommandent donc de recourir à des méthodes complémentaires telles que la mesure du tour de taille ou l’analyse de la composition corporelle, et de ne jamais négliger les facteurs individuels : génétique, habitudes de vie, rythme d’activité physique et alimentation.
Sources :
- Obésité - chu-lyon.fr
- L’obésité n’est pas qu’un excès de poids : c’est une maladie chronique - frm.org
- Obésité - sante.gouv.fr
- Guide du parcours de soins : surpoids et obésité de l’adulte - has-sante.fr